Revue Figaro
23 août 2024
21 août 2024
Le Figaro - Hors-Série N° 12 - 21 août 2024
| |
Numéro spécial hommage : 100 pages
Dont : |
Source : Le Figaro
On avait tous en nous quelque chose d’Alain Delon. On a tous en mémoire, associés à ce géant du grand écran qui a traversé les décennies avec la souplesse d’un guépard, une image, un mot, un regard, une expression, un souvenir, une émotion. Pour les uns, c’était la beauté sauvage et irradiante du comédien révélé dans les années 1960 grâce aux caméras de Visconti, Losey et Clément. Pour les autres, c’était l’acteur confirmé, volontiers taiseux et énigmatique, aristocratique, presque lointain, saisi par Melville et Verneuil. Pour d’autres encore, c’était le flic redresseur de torts, sauvant et vengeant la veuve et l’orphelin plus souvent qu’à son tour.
Mais Delon parlait à tous les Français parce qu’il était plus que ses personnages au cinéma : un tempérament, une gueule, une parole libre, un esprit d’aventure, des engagements audacieux, des relations extravagantes, une arrogance assumée. Il était aussi un homme, tout simplement, avec ses failles et ses fulgurances ; un fils démuni qui avait trouvé chez ses mentors du septième art des pères de substitution ; un amoureux tour à tour transi et intransigeant ; un père de famille imparfait, qui n’avait pas su fonder un clan uni comme son rival et frère de pellicule Jean-Paul Belmondo (en témoignent les récents et tristes conflits opposant ses deux fils Anthony et Alain-Fabien à sa fille Anouchka) ; un ami exigeant ; un chef d’entreprise plus ou moins avisé ; un collectionneur éclectique ; un lecteur attentif. On admirait avec une distance respectueuse son talent hors norme et son jeu unique, mais on se sentait proches de lui dans ses erreurs et ses errements, qui disaient sa sincérité et le rendaient tendre, touchant, humain, trop humain. Dans sa recherche éperdue de l’amour du public, des femmes ou des siens, il nous ressemblait, sublimant sur grand écran les sentiments communs qui nous habitent.
On a tous en nous, pour toujours, quelque chose d’Alain Delon.
Le samouraï est mort.
Jean-Christophe Buisson
Directeur adjoint du Figaro magazine
Au sommaire :
- Un géant
- L'album d'une vie
- L'acteur
- 30 films qui ont fait de lui une légende
- "Je sais ce que je suis, ce que je représente et ce que je vaux"
- la tentation du clap de fin
- "J'ai vécu tous mes rôles, je ne les ai jamais joués"
- Quelques coups de théâtre
- Ses mentors
- "Visconti a guidé ma vie"
- "Melville et moi, une communion"
- Intime
- Les femmes de sa vie
- Le rebelle au coeur tendre
- La famille d'abord !
- "Je dois ma vie et ma carrière aux femmes"
- Une fascination pour la pègre
- Le collectionneur
- Acteur à son affaire
- Gaulliste un jour, gaullliste toujours
- Autoportrait
- Ses lettres
12h01 dans Presse - 2024, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
31 janvier 2024
Le Figaro TV - N° 2257 - 27 janvier 2024
Les confessions intimes de Romy Schneider
Un entretien accordé en 1976 par la star à la journaliste Alice Schwarzer sert de fil rouge à un documentaire poignant diffusé ce mercredi 31 janvier 2024 à 21h sur la chaîne Le Figaro TV Île-de-France
La nuit est tombée sur Cologne en ce 12 décembre 1976, quand Romy Schneider entre dans le petit bureau d'Alice Schwarzer. Cette journaliste, qui prépare la sortie d'un nouveau magazine féminin, a rencontré la star cinq ans auparavant pour lui demander de signer un manifeste exigeant des pouvoirs publics la légalisation de l'avortement. De ce paraphe, qui a été immédiat, sont nées une complicité intellectuelle, une amitié sans faille et une confiance, à l'origine d'une confession, fil conducteur de ce documentaire réalisé par Patrick Jeudy et narré par Denis Podalydès, de la Comédie-Française.
Plusieurs heures durant, ce n'est pas la star mais la femme qui se confie comme jamais. Avec son accord, ces confessions ont été enregistrées sur une cassette qui, dès le lendemain matin, a été enfermée sous clés dans un tiroir.
Un passé encombrant
Alice Schwarzer a en effet jugé qu'il n'était pas question de rendre public un dialogue aussi intime. Il lui a fallu trente-cinq ans pour changer d'avis et faire de ce document sonore le fil conducteur de Conversation avec Romy Schneider. La journaliste revient devant la caméra de Patrick Jeudi sur cette nuit unique lors de laquelle la star a levé le voile sur la femme qu'elle était. Le désespoir moral de Romy est alors aussi évident que poignant. À 38 ans, au sommet de sa gloire, celle qui est alors le symbole de la femme moderne et libérée évoque des images qui, loin des caméras, n'ont jamais cessé de hanter sa vie. Elle se souvient, avec horreur, du moment où elle a compris que Magda, sa mère, actrice elle aussi, avait été extrêmement proche des nazis. Pendant la guerre, elle s'est rendue à plusieurs reprises à Berchtesgaden, au Berghof, la résidence secondaire de Hitler. Sa fille se demande même, la gorge serrée, si sa mère n'a pas flirté avec le chancelier du Reich. Prise dans un tourbillon médiatique depuis le tournage, à 15 ans, de son premier film, elle n'a jamais trouvé le temps de se poser les vraies questions sur ce qu'elle appelle un passé "encombrant".
Son rêve le plus cher
Romy Schneider ne manque pas d'évoquer son dégoût pour un beau-père, hôtelier et chef cuisinier, qu'elle appelait "Daddy", au bras duquel, tout sourire, elle a monté les marches du Festival de Cannes. Quelque temps seulement après son mariage avec Magda, celui-ci a tenté d'abuser d'elle.
Elle est parvenue à lui échapper en s'enfermant dans les toilettes de la maison familiale. Elle dit son écœurement pour une presse que l'on n'appelait pas encore people, qui, en Allemagne, n'a jamais cessé de l'insulter, de la traquer, avec l'espoir de trouver la matière d'un scandale susceptible de faire exploser les ventes. Surtout après qu'elle a refusé de tourner le quatrième volet de "Sissi". Elle se remémore enfin une histoire d'amour avec Alain Delon qui s'est transformée en une amitié éternelle. C'est grâce à lui que, dans "La Piscine", elle a pu lever un coin du voile sur son véritable visage : celui d'une femme toujours sensuelle mais qui moralement avait mûri. Elle a alors formé le vœu de mener une vie heureuse, sans le moindre tourment. Le destin ne lui a pas permis de concrétiser ce qui était sans doute son rêve le plus cher.
Par Jacques Pessis
15h42 dans Presse - 2024, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
15 mars 2022
05 janvier 2021
Le Figaro - 06 janvier 2021
Source : Le Figaro.fr - 04 janvier 2021
Source photo du quotidien : Facebook Jean-Pierre Lavoignat
|
Article intérieur : * Sarah Biasini, du rire aux larmes 1 page |
Sarah Biasini, du rire aux larmes
PORTRAIT - Elle-même devenue mère, la fille de Romy Schneider publie un livre dans lequel elle évoque la figure de celle qu’elle a perdue à 4 ans et demi.
On dirait la Fée Clochette. Un rire cristallin qui éclabousse tout. Un regard qui se plante dans le vôtre. Un sourire franc. Lorsqu’on la rencontre, chez Stock, son éditeur, quelques jours avant Noël, Sarah Biasini - qui publie cette semaine son premier livre, "La Beauté du ciel" (Stock) -, ne joue pas à l’apprentie romancière qui aurait été touchée comme par magie par la grâce de l’écriture. Elle ne prend pas de poses. Ne force pas non plus la dose de la sinistrose. Elle pourrait pourtant se montrer accablée, rongée par son lourd destin. Seulement voilà, la comédienne s’en tient à une gaieté pudique et surtout rejette tout pathos.
Ce n’est visiblement pas le genre de la maison. «J’ai été élevée comme ça. Avec l’idée qu’il y a plus malheureux que soi, qu’il ne faut pas pleurnicher. Ce qui m’est arrivé arrive malheureusement à plein de familles. Cela fait partie de la vie», dit-elle, avant d’éclater de rire. De toute façon, c’est arrivé, Cyrulnik, la résilience, il faut en faire quelque chose !»
Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 85% à découvrir.
Par Anne Fulda
18h35 dans News Sarah, Presse - 2021, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
23 septembre 2018
13 juin 2018
Trois jours à Quiberon : «Romy Schneider ressuscitée» dans un «anti-biopic»
Source : Le Figaro - 13 juin 2018
REVUE DE PRESSE - N'en déplaise à Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, choquée par la représentation de sa mère en alcoolique dépressive, le film d'Emily Atef a séduit la critique. Une actrice «miraculeuse», un noir et blanc «somptueux» et la «justesse émotionnelle» du récit ont fait mouche.
Le biopic [NDLR : Ce film n'est pas un biopic !!!] dramatique d'Emily Atef prend place en Bretagne, durant une thalassothérapie. L'actrice Romy Schneider accepte une interview exceptionnelle, un an avant sa mort. Pendant plusieurs jours, elle va se livrer au journaliste Michaël Jürgs, par amitié pour le photographe Robert Lebeck qui l'accompagne. Lui raconter ses souffrances de mère, d'actrice, pour le magazine Stern. En pleine dépression, l'alcool la pousse à se confier, malgré les efforts de son amie Hildegard pour la protéger des «vautours». La réalisatrice franco-libanaise Emily Atef signe avec "Trois Jours à Quiberon" son quatrième long-métrage. Il a plu à la critique, ravie d'y retrouver l'essence de l'actrice des "Choses de la vie".
Une ressemblance qui conquiert la critique
La presse est époustouflée par la ressemblance de Marie Bäumer avec Romy Schneider. Ce rôle lui a valu en avril l'équivalent du César allemand, un "Lola" de la meilleure actrice [NDLR : le "César" allemand]. Pour Emily Barnett des Inrocks, elle est le «sosie de Romy Schneider». Son «interprétation solaire et torturée tend à gommer l'icône au profit de la femme confrontée à la tyrannie de son image.» Barbara Théate renchérit dans le Journal du Dimanche : «Marie Bäumer, lumineuse, fait preuve d'une grande justesse émotionnelle dans les excès de joie comme de peine».
L'actrice allemande de 49 ans est tout simplement «un miracle» pour Nicolas Schaller de L'Obs : «Tout trouble chez elle: sa ressemblance jamais forcée avec la star de "César et Rosalie", son naturel, l'invisibilité de son jeu. Elle est Romy, ou du moins l'image qu'on s'en fait, dès sa première apparition, de trois quarts dos.» La ressemblance est frappante. Yannick Vely de Paris Match insiste : «Il ne faut surtout pas négliger le travail d'incarnation, la direction d'actrice et le soin méticuleux de la composition». Il s'enthousiasme pour un «mimétisme frappant». «L'on retombe à nouveau amoureux de la fragilité et de la détermination de la star, comme si elle revenait à la vie devant nos yeux», admire-t-il.
Des termes que l'on retrouve dans plusieurs critiques, émues par ce film qui mêle des éléments de documentaire et de fiction. Télérama titre sur «une reconstitution troublante» de la vie de la vedette. Le film «donne l'impression de voir Romy ressuscitée», note Jacques Morice. L'Obs acquiesce et applaudit «un portrait bien senti, porté par de fines intuitions». «Mieux qu'un biopic, "Trois jours à Quiberon" est un instantané au travers duquel se profile une vie entière», analyse Nicolas Schaller. Étienne Sorin du Figaro est conquis : «Emily Atef évite les réponses toutes faites et la psychologie de comptoir». Son confrère Éric Neuhoff partage ce point de vue. Il assure que «ces "Trois jours" forment le contraire d'un biopic, cernent peut-être le moment où une vie risque de basculer». Pour lui, «il s'agit d'un instantané, d'une rêverie».
Le choix du noir et blanc est un succès
Seul Le Monde s'oppose à ces éloges, regrettant une absence de «point de vue» dans le biopic. Véronique Cauhapé est déçue par les sources sur lesquelles la réalisatrice s'est appuyée. Pour la journaliste, l'entretien publié dans Stern, et les photos prises à cette occasion «se révèlent insuffisants pour faire décoller le film.» «Faute de point de vue, "Trois jours à Quiberon" se contente d'aligner une succession de plans sur une actrice en proie au mal-être, réduisant l'envergure du film à celle d'un reportage au commentaire insignifiant et simpliste», tranche-t-elle.
Le choix du noir et blanc, qualifié d'«impressionniste» par Les Échos permet, lui, de fédérer unanimement la critique. Pour L'Obs, il rappelle celui «des photos de Lebeck, celui du souvenir, des cendres d'une époque où l'on fumait dans le hall des hôtels-sanatoriums». Un parti pris qui «donne une belle intensité à cette plongée quasi documentaire dans l'intimité et la souffrance d'une actrice connue pour sa fragilité», remarque Barbara Théate du JDD.
Cécile Rouden de "La Croix" conclut en rappelant l'histoire d'amour entre l'actrice allemande et l'Hexagone : «En France, où on a aimé passionnément Romy, il est difficile de ne pas être touché par ce film tourné en Bretagne dans un somptueux noir et blanc qui renvoie aux photographies de Robert Lebeck».
Par Julia Benarrous
21h32 dans Films-Romy, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
11 novembre 2016
Le Figaro - N° 22.474 - 11 novembre 2016
|
Article intérieur : 1/4 page |
Source : TVmag - Le Figaro - 11 novembre 2016
FRANCE 3/20H55 - Le documentaire Romy de tout son cœur raconte l’actrice, à partir de son journal intime lu par Isabelle Carré, de témoignages et d’images rares. Le réalisateur nous en dit plus.
Quelle était votre intention ?
Il me manquait une Romy, celle qui permet de comprendre l’affection du public, la richesse de son talent, l’existence d’un prix portant son nom, ses deux César. Trop de documentaires se sont attardés sur la fin de sa vie. La lecture de son journal intime, Moi, Romy permet de trouver une cohérence entre les Heimatfilm, qu’illustre la trilogie des Sissi, et "Les Choses de la vie" de Sautet, "Le Train" de Granier-Deferre, ou "Le Vieux Fusil" d’Enrico. L’Autrichienne Romy, pensionnaire en Allemagne, a commencé à écrire à 11 ans dans un cahier surnommé «Peggy». Ses réflexions naïves, son franc-parler et sa perspicacité sur son métier touchent.
Pourquoi ce choix d’Isabelle Carré pour en lire des extraits ?
Prix Romy-Schneider 1998, Isabelle doit beaucoup à la comédienne. J’ai découvert qu’elle avait lu son journal et que c’est par le biais de la lettre de rupture d’Alain Delon qu’Isabelle a relevé le nom de Georges Beaume, son premier agent ! Enfin, elle a obtenu ses premiers rôles grâce à la lettre à Hélène des Choses de la vie!
Pourquoi ce titre Romy, de tout son cœur ?
Je le dois à Jean-Loup Dabadie, qui résume ainsi l’intensité absolue et l’énergie qu’elle donnait et dont parle aussi Gérard Klein, son partenaire dans La Passante du Sans-Souci.
Quelques raretés ?
Les images sublimes de "L’Enfer", film inachevé de Clouzot, dont Serge Bromberg a fait un documentaire ; un document allemand qui suit Romy en 66-67 avec son premier mari (Marcel Mayer) et le making-of de Sissi.
Pourquoi ne pas filmer les personnalités qui témoignent ?
Pour rester dans le présent de la narration sans décalage entre aujourd’hui et hier. Les voix de Gavras, Dabadie, Denys Granier-Deferre et du compositeur Philippe Sarde s’entendent ainsi comme une confidence.
Une découverte ?
La tension de Romy due à la crainte de ne pas avoir bien compris la langue. Elle ne supportait pas que l’on change les dialogues. Et le désamour de la presse allemande à son égard.
Propos recueillis par Isabelle Mermin
À savoir
Après Joe Dassin et Serge Reggiani, Pascal Forneri reprend ses narrations pour Romy Schneider. On lui doit quelques Fais pas ci, fais pas ça, le livret de la comédie musicale Salut les copains et Ces chansons qui nous ressemblent, sur France 3. Il prépare une fiction musicale pour la chaîne dans l’esprit du film Anna (1967), avec Serge Gainsbourg, ou de La La Land, bientôt au cinéma.
11h38 dans Presse - 2016, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
14 octobre 2015
Quand Marilyn et Romy posaient nues dans Playboy
Source : Le Figaro.fr - 13 octobre 2015
Le magazine fondé par Hugh Hefner en 1953 va cesser de publier des photos érotiques dans ses pages. Pendant plus d'un demi-siècle la beauté des plus belles actrices du monde a fait sa réputation. Revue de charme.
C'est la fin d'une époque. Il y a quelques semaines le nouvel éditeur du magazine de charme Playboy, Cory Jones, a rencontré Hugh Hefner, le fondateur historique de la revue, pour lui signifier qu'il n'y aurait plus désormais de photos de femmes nues dans ses pages.
La révolution numérique est, semble-t-il, à l'origine de cette décision radicale. Dans un entretien accordé à notre confrère américain, le New York Times, Cory Jones a donné un argument implacable: «La libération sexuelle a été gagnée. Playboy était pionnier mais aujourd'hui il suffit d'un seul clic, et vous pouvez voir toutes les images osées ou provocantes gratuitement. Playboy et ses premières images sulfureuses appartiennent désormais à l'Histoire.»
Les statistiques de vente du magazine sont cruelles et corroborent l'analyse du nouveau patron de Playboy. En 1975 sa diffusion avait atteint les 5,6 millions d'exemplaires. Aujourd'hui elle ne dépasse plus guère les 800.000 exemplaires par mois.
Les plus belles femmes du monde ont posé nues ou presque nues pour le journal de Hugh Hefner. Le Figaro a choisi de vous présenter les plus indiscutables icônes de la revue.
Marilyn Monroe en 1953
Marilyn appartient à l'histoire de Playboy. En novembre 1953, elle devient la première playmate du journal. La bombe sexuelle est née. Depuis toutes les éditions internationales de la revue de charme ont exploité à l'envi son sourire et son incomparable plastique. Marilyn Monroe appartient à la légende Playboy
Ursula Andress en 1965
En 1962 Dans Dr No, Ursula Andress inventa l'idée même de la James Bond Girl. Au faîte de sa gloire, en 1965, elle accepte de poser pour Playboy. C'est alors considéré comme un choix particulièrement osé, presque sulfureux. Ursula Andress a été la première des James Bond Girls.
Romy Schneider en 1980
L'inoubliable actrice franco-allemande a attendu 1980 pour poser dans le magazine de Hugh Hefner. Ses huits nus artistiques étaient accompagnés d'entretiens exclusifs avec deux de ses réalisateurs fétiches, Claude Sautet et Francis Girod.
Par Bertrand Guyard
10h43 dans Presse - 2015, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (1)
18 avril 2014
04 janvier 2014
Nina Companeez : «Samuel Le Bihan m'a scotchée»
Source : Le Figaro.fr - 04 janvier 2014
Dans "Le Général du roi "que diffuse France 3, Samuel Le Bihan et Louise Monot forment un couple passionné pris dans la tourmente de la Révolte des chouans. Nina Companeez, la réalisatrice raconte les coulisses de ce film.
Avec "Les Dames de la côte", "L'Allée du roi" et bien d'autres séries, Nina Companeez a créé l'événement à la télévision. "Le Général du roi" ne fait pas exception. S'inspirant du roman éponyme de Daphné du Maurier qui se déroulait dans l'Angleterre de Cromwell, où un fougueux officier de marine tombait amoureux d'une fière aristocrate de province devenue infirme, elle a transposé ses héros un siècle et demi plus tard, en Vendée, pendant la Révolte des chouans.
«Ce n'est pas mon histoire, précise la réalisatrice d'origine russe, mais je suis sensible aux persécutions et à l'intolérance et j'ai essayé de faire revivre cette tragédie civile assez méconnue.» Mais le pari n'était pas gagné. Pour convaincre le Conseil général vendéen de l'aider (celui des Pays de la Loire ayant refusé), elle a dû prouver qu'elle savait de quoi elle parlait. «Au final parfois, j'en savais plus qu'eux», s'amuse-t-elle. Du coup, la Région a même mis à sa disposition, pour servir de cadre à la maison de Constance, le logis de la Chabotterie où le général Charrette fut arrêté et soigné avant d'être fusillé à Nantes.
«Au départ, c'est mon héroïne en fauteuil roulant qui me plaisait. J'aime les héroïnes résilientes. Elle est infirme mais ne capitule pas. C'est une orgueilleuse active», explique la réalisatrice qui porta rapidement son choix sur Louise Monot, vue dans Mademoiselle Drot. Une comédienne qui a passé 24 heures dans un fauteuil roulant pour s'approprier le personnage. Mais pour son général «si rude, si mal élevé et si doux avec son amoureuse», la réalisatrice n'avait pas immédiatement songé à Samuel Le Bihan. «Il n'avait pas ce côté féminin que l'on retrouve chez Giraudeau, Sandre ou Huster avec lesquels j'ai beaucoup tourné. Mais comme je me suis inspirée pour ce personnage du général Charette qui était une force de la nature, je suis allée voir l'acteur au théâtre. Nous avons pris un verre ensuite. Et là il m'a scotchée. J'ai été séduite complètement». Et nous aussi.
À savoir
Mars 1793 : début de la Révolte des chouans qui opposera royalistes et républicains en Vendée, avec la première insurrection paysanne. C'est seulement après l'exécution du dernier chef, François-Athanase Charette, en mars 1796, que cette guerre civile qui fit 180.000 morts (sur 815.000 habitants) s'arrêta.
10h53 dans FilmTV-2013-Général Roi, Presse - 2014, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
06 juillet 2012
26 juin 2012
28 juin 2010
22 décembre 2009
Romy Schneider fichée par la Stasi
Romy Schneider (ici en 1969) a été «dans le viseur de la Stasi en raison de son engagement politique», a précisé à l'AFP Steffen Mayer, porte-parole de l'Office chargé de la gestion des archives de la Stasi.
La police secrète est-allemande a recueilli des informations sur l'interprète de "Sissi" lorsqu'elle a adhéré en 1976 à un comité, qui militait pour la libération des prisonniers politiques de la RDA.
Romy Schneider «ennemi d'Etat de la RDA». Vingt ans après la chute du mur de Berlin, l'ouverture des archives de la Stasi se révèle en surprises. Parmi les 4 millions de personnes fichées par la redoutable police est-allemande, se trouve la comédienne autrichienne, indique lundi le quotidien Bild. La Stasi a ouvert un dossier sur l'interprète de Sissi lorsque celle-ci a adhéré en 1976, à 38 ans, à un «comité de protection de la liberté et du socialisme», qui militait pour la libération des prisonniers politiques est-allemands.
Cette plateforme de protestation, qui réunissait des personnalités de toute l'Europe, inquiétait les dirigeants de la RDA. Ils ont demandé à ce que des informations soient recueillies sur les membres de ce comité. Lorsque Romy Schneider a signé l'appel de l'organisation, la Stasi a considéré ce geste «comme une déclaration de guerre», indique Bild. Le dossier de 38 pages sur la comédienne note ainsi que Romy Schneider était plus qu'une simple membre du comité. Elle lui a aussi donné de l'argent et a rallié à sa cause son ami Yves Montand, avec qui elle avait filmé "César et Rosalie", et sa compagne Simone Signoret. Le couple mythique d'artistes est ainsi désigné par la Stasi comme «membres correspondants».
Romy Schneider, une personne «hostile et négative».
«En septembre 1981, Romy Schneider a paraphé la «lettre ouverte au camarade Brejnev» de Havermann, un opposant à la RDA», poursuit le dossier. En raison de ses activités politiques, la Stasi labelle la comédienne comme une personne «hostile et négative». Dès que Romy Schneider voyage en passant par la RDA, sa fiche répertorie les personnes qui l'accompagnent et tous les documents inhérents au voyage. La dernière entrée de la Stasi remonte au 7 juin 1982, huit jours après la mort de l'actrice. Est inscrite à la main la mention «décédée le 25 mai 1982».
Dix-neuf après la réunification, l'ombre de la Stasi plane toujours sur l'Allemagne. Régulièrement, les 195 km de rayonnages d'archives laissent échapper des secrets encombrants. Ainsi a-t-on a appris en novembre dernier, que plusieurs élus du parti de la gauche radicale «Die Linke» de l'Etat du Brandebourg -surnommé la petite RDA- ont collaboré avec la Stasi.
Au total, la police secrète du ministère de la Sécurité d'État de la RDA a employé quelque 620.000 personnes, dont 12.000 ressortissants d'Allemagne de l'Ouest entre 1950 et 1989. Au moment de sa dissolution, en 1989, environ 91 000 agents officiels œuvraient pour la Stasi, qui pouvait également compter sur 175 000 informateurs non officiels, les célèbres «IM» (Inoffizieller Mitarbeiter). Soit 1 % de la population est-allemande.
Constance Jamet
o0o o0o o0o
Source : Bild.de - 21 décembre 2009
So geriet Sissi ins Visier der Stasi
Millionen sahen im ZDF "Sisi" – die Neuverfilmung des Klassikers von 1955. Damals hatte sich die große Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth in die Herzen der Zuschauer gespielt. Doch auch die Stasi interessierte sich für den Weltstar...
Romy Schneider unterstützte die DDR-Opposition. Auch mit Geld. Deshalb wurde sie überwacht und ausspioniert.
Sie galt als Staatsfeindin der DDR.
Das belegen Stasi-Akten, die die Birthler-Behörde auf Antrag von BILD herausgab.
Sprecher Steffen Mayer : "Romy Schneider geriet aufgrund ihres politischen Engagements ins Visier der Stasi. Der DDR-Geheimdienst legte Karteikarten über sie an und sammelte Informationen."
Romy Schneider engagiert sich in einem "Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus". Dieses wurde 1976 in West-Berlin gegründet und setzte sich für die Freilassung von politischen Häftlingen der DDR ein.
Als sie einen öffentlichen Aufruf unterschreibt, betrachtet das die Stasi als Kriegserklärung.
Am 28. Dezember 1976 wird vom Ministerium für Staatssicherheit ein "Suchauftrag" gegen Schneider erlassen. Sondervermerk : "Eilt". Am 19. Januar 1978 folgt ein "Fahndungsersuchen." Rechts oben in der Ecke des Befehls steht: "Geheim!"
Mit dem Dokument werden gegen die "Person Schneider, Romy – geboren am 23.9.1938 in Wien, österreichische Staatsbürgerin, Schauspielerin, wohnhaft Berlin, Winklerstraße 22" – folgende Fahndungsmaßnahmen erlassen :
• Dokumentierung der Reiseunterlagen
• Dokumentierung mitreisender Personen.
• Verständigung der auftraggebenden Einheit.
Das heißt : Sobald die Schauspielerin durch die DDR (Transit) fährt, werden alle Daten an die Stasi-Hauptabteilung XX/5 gemeldet.
In einem weiteren Aktenvermerk hält ein Stasi-Oberleutnant fest : "Sch. unterstützte die Aktivitäten des "Schutzkomitees" durch finanzielle Zuwendungen und gewann Yves Montand und Simone Signoret als Mitglieder." Weiter heißt es : "Am 25.9.1981 trat sie als Unterzeichnerin des ‚offenen Briefes‘ von Havemann (Regime-Kritiker, d. Red) an den Genossen L. Breshnew (Staatschef der Sowjetunion, d. Red.) in Erscheinung."
Die Stasi-Akte endet am 7. Juni 1982, wenige Tage nach dem Tod von Romy Schneider (†43). Handschriftlich ist vermerkt : "29.5.82 verstorben."
H.-W. SAURE
09h07 dans Biographie, Presse - 2009, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
06 novembre 2009
Le Figaro Magazine - N° 1107 - 07 novembre 2009
|
Article intérieur : 4,5 pages |
- Source : Figaro.fr - 06 novembre 2009
Il était une fois Romy
Un incroyable documentaire exhume des images du film sulfureux et inachevé d'Henri-Georges Clouzot, «L'Enfer». L'héroïne en était Romy Schneider, dans son rôle le plus érotique. Flash-back sur une vie marquée par la grâce et le drame, les passions et les malentendus.
Romy, dans éL'important c'est d'aimeré, en actrice déclassée. Assise sur un type en sang, sadisée par une réalisatrice hystérique. Elle n'arrive pas à dire son texte, ce «Je t'aime» grotesque, impossible. Elle lève les yeux, implore un photographe joué par Fabio Testi : «Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez. Je sais faire des trucs bien.» Le début du film d'Andrzej Zulawski nous revient toujours en flash, en écho. De ces mots fiers, suppliés, engorgés de chagrin et de fureur, filtre quelque chose d'incompris, d'inconsolable, de fatal, qui dépasse leur sens littéral. Car, en 1974, personne ne doute que Romy Schneider sache «faire des trucs bien». A 36 ans, c'est l'une des plus belles actrices du monde, des plus rigoureuses, des plus acharnées. Après avoir débuté à 15 ans dans le cinéma académique austro-allemand, elle s'est décollée de la guimauve de la trilogie des Sissi qui ont fait sa gloire adolescente pour tourner avec Otto Preminger, Orson Welles, Luchino Visconti, Claude Sautet. Ce n'est donc pas le cinéma qui inquiète Romy. Ni de se montrer nue, comme en témoignent les belles photos d'Eva Sereny ou de Giancarlo Botti. Plus loin dans le film, elle lâche «Je suis paumée» à un comédien désaxé joué par Klaus Kinski. Sur le tournage du chef-d'œuvre de Zulawski, qui lui vaudra le césar de la meilleure actrice, elle arrivait avec du champagne et du bordeaux dans un sac plastique et les partageait avec son partenaire Jacques Dutronc. Lors d'une prise, elle s'est écrasé le visage contre un mur de parking.
Elle est née Rosemarie Albach-Retty, en Autriche, à Vienne, le 23 septembre 1938, un an après le mariage de ses parents, Magda Schneider et Wolf Albach-Retty, deux gloires du cinéma allemand. L'enfant de la balle, très tôt surnommée Romy, a passé son enfance dans le chalet familial en Bavière, non loin de Berchtesgaden et duBerghof, le repaire d'Hitler. Magda Schneider plaisait à Hitler, au point d'être invitée au Nid d'aigle, comme on l'a vu récemment dans le documentaire Apocalypse. Les images montrent aussi la petite Romy jouant innocemment avec d'autres gosses au pied du chef nazi. Plus tard, elle soupçonnera Magda d'avoir couché avec Hitler.
Etrange jeunesse de Romy. Amputée d'un père parti avec l'actrice Trude Marlen. Cloîtrée dans un pensionnat. Flanquée d'une mère possessive qui rame pour retrouver des rôles après la chute du Reich. En 1953, pour ses débuts dans "Les Lilas blancs", d'Hans Deppe, Romy prend le nom de sa mère dans un film où Magda tient la vedette. Quand elle voudra se faire appeler Albach, il sera trop tard, le succès l'aura baptisée sous le nom maternel. Jusqu'en 1958, Magda apparaît souvent au générique des films de sa fille, notamment dans la série des "Sissi" d'Ernst Marischka, où elle joue la mère de l'héroïne. Romy sert la carrière de Magda, sous l'œil cupide d'un beau-père, Hans Blatzheim, qui aurait plusieurs fois tenté de coucher avec elle. La jeune actrice a donc des raisons d'étouffer, de ronger son frein.
Avec Delon, les rapports sont d'abord agressifs
De sous la très lourde perruque de Sissi dépassent des mèches rebelles. Elle déteste cette princesse sucrée aux antipodes de son caractère libre, foutraque, acide, déluré. Quand Pierre Gaspard-Huit lui propose "Christine", une adaptation de "Libelei", la pièce d'Arthur Schnitzler qui avait révélé sa mère, il semble que Romy n'en finisse jamais avec Magda. En fait, ce film va la libérer de sa famille, de l'Allemagne. Elle choisit sur photo son partenaire à l'écran : le jeune Alain Delon, qui vient l'attendre à sa descente d'avion à Paris. Au début, leurs rapports sont froids, agressifs, comme il sied aux félins. Ils s'apprivoisent vite. Magda sent le danger, elle aime l'ordre et Delon fait désordre, trop sulfureux. Romy s'en fout. Elle rejoint Delon en France.
Romy et Delon. «Les fiancés de l'Europe.» Des rôles en or dans la cage aux people. Mais ces deux-là sont trop viscéralement acteurs pour se la jouer dans la vie. Ils s'aiment comme on aime à 20 ans, bien et mal, mais comme on n'aime plus jamais ensuite. Sortant de Rocco et ses frères, Delon présente Romy à Visconti. Cadeau plus durable qu'une bague de fiançailles. Pour eux, l'aristocrate italien monte la pièce de John Ford, "Dommage qu'elle soit une p...". Romy retrouvera Visconti dans "Boccace 70 et "Ludwig ou le crépuscule des dieux". Un jour, elle nommera ses «quatre maîtres : Visconti, Welles, Sautet et Zulawski. Le plus grand est Visconti». Le couple se sépare en 1963. Delon a rencontré Nathalie, sa future femme. Il aurait écrit une lettre de rupture à Romy pendant qu'elle tournait à Hollywood, avant de lui laisser en guise d'adieu des fleurs, qu'elle aurait trouvées à son retour dans l'hôtel particulier qu'il avait déserté. D'après Delon, cette histoire de lettre et de bouquet est «complètement bidon». Façon de dire qu'en amour il n'y a ni bourreau, ni victime.
En 1964, débute le tournage de "L'Enfer", d'Henri-Georges Clouzot, avec Serge Reggiani. Un film sur la jalousie, inachevé et maudit, auquel Serge Bromberg et Ruxandra Medrea viennent de consacrer un passionnant documentaire. Les images retrouvées sont inouïes et révèlent le potentiel érotique d'une Romy fantasmée par les recherches en art cinétique du réalisateur. Elle vampe, allume, danse du ventre. On la voit même ligotée seins nus sur une voie ferrée. Sous le viaduc de Garabit, Clouzot s'enferre et déraille, tourne et retourne les mêmes scènes, se cogne un infarctus qui arrête les frais. Epuisé, Reggiani avait déjà quitté le tournage. A l'époque, Romy et Serge étaient très liés, elle débarquait souvent chez lui avec du whisky. Si l'actrice jouait en apnée, la femme tanguait, cherchait à s'arrimer. En 1966, elle se marie avec l'acteur et metteur en scène allemand Harry Haubenstock (dit Meyen), de quatorze ans son aîné. Leur fils David naît la même année. A Berlin, puis à Hambourg, Romy va jouer à l'épouse rangée, mais les crises couvent.
Delon est encore là, en ami. En 1968, il l'appelle pour jouer dans "La Piscine", de Jacques Deray, qui relance la carrière française de Romy. L'année suivante, c'est Les Choses de la vie, de Claude Sautet, avec Michel Piccoli. Sautet sait la regarder et parler d'elle : «Romy, c'est la vivacité même, une vivacité animale, avec des changements d'expression allant de l'agressivité la plus virile à la douceur la plus subtile.» Elle «dépasse le quotidien», prend «une dimension solaire». "César et Rosalie", "Max et les ferrailleurs", "Une histoire simple" feront d'elle le modèle de la femme française.
En Allemagne, elle est plutôt mal vue. Pour avoir signé en 1971, dans le magazine Stern, un manifeste féministe où elle reconnaissait avoir avorté, on la menace d'amende, de prison. On ne lui pardonne pas son exil ni qu'elle incarne une juive allemande fuyant les nazis dans "Le Train", de Pierre Granier-Deferre. En 1975, Romy retournera le couteau dans la plaie en jouant Clara dans "Le Vieux Fusil", de Robert Enrico. La scène du viol de Clara par les SS sera censurée outre-Rhin. En la tournant, l'actrice avait rageusement balancé un comédien dans l'escalier.
Au début des années 70, son mariage se désagrège. Elle sort avec le somptueux producteur américain Robert Evans, elle se passe du Jacques Dutronc en boucle, elle part au Maroc avec Bruno Ganz. Dans la ronde des liaisons erratiques surnagent des amitiés fortes.
Un rire qui saute au visage
Elle fête ses anniversaires avec le scénariste Pascal Jardin, prodigieux écrivain de La Guerre à neuf ans. Au bout du rouleau avec Meyen, elle divorce en 1975, et se remarie vite avec Daniel Biasini, son ancien secrétaire, de onze ans son cadet. Leur fille Sarah naîtra en 1977.
Sur nombre de photos, le rire de Romy saute au visage. Mais, comme le rappelle Emmanuel Bonini, l'un de ses biographes, en citant Romain Gary : «Le rire, c'est parfois une façon qu'a l'horreur de crever.» L'héroïne de "Clair de femme", adapté par Costa-Gavras, rira de moins en moins, et l'horreur sera complète. En 1979, Meyen se pend avec une écharpe blanche en Allemagne. Dans "L'important c'est d'aimer", le comédien germanique et désaxé incarné par Kinski portait une écharpe blanche. En 1980, à la cérémonie des Césars, elle critique cruellement Miou-Miou qui n'est pas venue chercher son trophée. Sur "La Banquière", de Francis Girod, elle affiche à la porte de sa caravane : «Entrée permise seulement à mes amis : Dany, Jean-Claude, Francis et quelques autres aussi, mais j'suis discrète et j'suis méfiante. Romy.» Elle jugule l'angoisse à grandes doses d'alcool et de médicaments. Son union avec Biasini, qui vient de coécrire Un mauvais fils, de Sautet, agonise. En juillet 1981 survient le drame ultime : son fils David, 14 ans, s'éventre en escaladant la grille de la maison des parents de Biasini et succombe peu après. Dévastée, Romy doit encore affronter les paparazzis. Chaque photo volée vole son âme. Mais elle a tant d'âme. Elle s'accroche au projet qu'elle a initié : "La Passante du Sans-Souci", un roman de Joseph Kessel, librement adapté par Jacques Rouffio. Elle y retrouve Michel Piccoli. C'est l'histoire d'une femme qui veut sauver son mari des nazis à Berlin et qui protège un enfant juif à Paris. L'enfant ressemble à David. Elle tourne au bout du chagrin. Cette prestation somnambulique, éblouissante, sera la dernière. On ne la verra pas dans le rôle qu'elle ambitionnait, celui d'Ulrike Meinhof, la terroriste allemande d'extrême gauche, compagne d'armes d'Andreas Baader.
La mort au bout du chagrin
«Qu'on me laisse enfin tranquille», c'est le message qu'elle adressera lors d'un entretien télévisé avec Michel Drucker où, vibrante et laminée, elle revient sur la profanation médiatique de David : «Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort... (...) Où est la morale ? Où est le tact ?» La morale et le tact conduiront le magistrat Laurent Davenas à ne pas ordonner d'autopsie le 29 mai 1982, quand Laurent Pétin, le dernier compagnon de Romy, aujourd'hui producteur, la retrouvera sans vie au petit matin dans l'appartement qu'ils partagent à Paris. Abus accidentel d'alcool et de médicaments ? Suicide ? Maladie ? Qu'importe. L'expression «mort naturelle» convient bien à celle qui semblait si lasse de vivre. Elle repose dans un cimetière des Yvelines. Sous le nom de Rosemarie Albach. Sur sa tombe, on aurait pu graver ces mots de Zulawski : «Elle payait de sa vie ce qu'elle montrait de beau à l'écran.»
Jean-Marc Parisis
21h50 dans Biographie, Presse - 2009, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (2)
Le Figaro - N° 20301 - 06 novembre 2009
|
Article intérieur : 2 pages |
Source : Le Figaro.fr - 06 novembre 2009
Serge Bromberg dévoile les mystères de cette œuvre inachevée, dans un ouvrage et un documentaire passionnants.
Les images inconnues de "L'Enfer", film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, voient enfin le jour grâce à la passion et l'acharnement d'un homme qui en a tiré un livre magnifique, "Romy dans L'Enfer" et un documentaire palpitant, L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot (sortie mercredi prochain, voir critique). En 2005, Serge Bromberg, producteur et restaurateur de longs-métrages, exhume les 185 boîtes de films invisibles depuis un demi-siècle, « bloquées » pour raisons juridiques et soigneusement conservées aux Archives françaises du film. Seulement quinze heures d'images muettes, non montées, à partir desquelles Bromberg a tenté de reconstituer l'histoire de cette œuvre énigmatique, qui a alimenté les fantasmes des cinéphiles. "L'Enfer", un tournage maudit interrompu au bout de trois semaines par l'infarctus de son réalisateur. Une aventure démesurée, dantesque, au budget illimité. Un rêve artistique qui a viré au cauchemar. «À trop vouloir s'approcher de la perfection formelle et de son rêve improbable, il s'y est brûlé les ailes», estime Serge Bromberg à propos de Clouzot.
Le réalisateur n'a alors pas tourné depuis quatre ans. Il sort d'une dépression, s'est retiré à Tahiti où il a débuté l'écriture de L'Enfer qui devra, selon lui, révolutionner le cinéma. Il propose à Romy Schneider, 26 ans et à Serge Reggiani, 42 ans, d'en devenir les héros. Romy Schneider veut montrer que Sissi est loin. Clouzot, séduit, réécrit pour elle la version finale de ce drame de la jalousie. Marcel Prieur (Serge Reggiani), patron d'un petit hôtel de province se demande si Odette (Romy Schneider), sa femme, ne l'a pas odieusement, scandaleusement, trompé. «Point de preuves : seulement des présomptions, mais terribles», écrit Clouzot.
La folie s'empare de Marcel. Clouzot veut filmer le cerveau malade de son héros. Mettre la paranoïa en image devient son obsession. Et puisque les producteurs de la Columbia lui ont offert un budget illimité, il en profite pour expérimenter différents procédés. Il met au point avec Éric Duvivier qui avait réalisé avec Henri Michaux Image du monde visionnaire, film illustrant des visions hallucinatoires sous mescaline un système d'éclairage particulier, l'Héliophore. Il se passionne pour les effets cinétiques, et demande à Joel Stein et Jean-Pierre Yvaral de collaborer avec lui. Pendant six mois, Clouzot tourne les essais préparatoires de "L'Enfer" dans le huis clos des Studios de Boulogne. Romy Schneider devient objet de fascination. Il la filme, des heures durant, le visage recouvert de paillettes et d'huile d'olive, ou bien peint avec un maquillage multicolore. Elle n'a jamais été aussi belle. Hypnotique, incandescente, érotique, sensuelle, elle se prête à tous les fantasmes, à tous les désirs cinématographiques de Clouzot. Son contrat précise qu'elle ne fera aucune scène dénudée. Pourtant elle accepte de tourner nue la séquence où, enchaînée aux rails de la voie ferrée, un train fonce sur elle.
Le tournage démarre en juillet 1964, à l'hôtel du Lac, au pied du viaduc de Garabit (Cantal). Clouzot est à la tête de trois équipes, véritable armée de cent cinquante techniciens. Mais le perfectionnisme du cinéaste, qui multiplie les prises, et le manque de coordination entre les troupes ralentissent considérablement le tournage. Tyrannique, insomniaque, il réveille ses techniciens pour parler du scénario, en réécrit les pages pour le lendemain. Les rapports avec Reggiani se détériorent. L'acteur, dépressif, est hospitalisé. On évoque la fièvre de Malte, transmise par le fromage de chèvre que Reggiani se fait livrer de Corse ! En fait, l'acteur n'a plus la force d'affronter le monstre sacré. Clouzot, usé, stressé, fait un infarctus. La production est temporairement interrompue. Les experts des assurances décident que le tournage ne reprendra jamais. L'Enfer aura coûté plus de 5 036 000 francs aux assurances. Clap de fin. Et début de la légende.
«Romy dans L'Enfer», texte de Serge Bromberg. Albin Michel-Lobster (25 €).
08h38 dans Film-1964-Enfer, Presse - 2009, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
30 octobre 2009
Madame Figaro - N° 20.296 - 31 octobre 2009
|
Article intérieur : 2 pages |
Source : Le Figaro.fr - 30 octobre 2009
Romy Schneider, la lumière et l'enfer
Elle n’aimait pas le mot «star»… Pourtant, vingt-sept ans après sa disparition, elle est devenue un mythe et la référence absolue des actrices. Quatre d’entre elles décryptent la légende Romy Schneider, au moment où L’Enfer, film inachevé de Clouzot, fait l’objet d’un documentaire.
par Sophie Grassain
En 1964, Romy Schneider croise le cinéaste Henri-Georges Clouzot, qui lui propose "L’Enfer", un drame névrotique sur la jalousie. Terrassé par un arrêt cardiaque, il ne terminera jamais le film. Serge Bromberg et Ruxandra Medrea font revivre ce tournage maudit grâce à L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot (voir la bande annonce à la fin de l’article), un documentaire balisé de témoignages et d’extraits où Bérénice Bejo et Jacques Gamblin lisent des scènes cruciales qui ne furent jamais filmées.
À l’époque, Clouzot y altère le son, y expérimente des images cinétiques et se noie dans sa quête esthétique. Pour lui, Romy est à la fois ange (l’épouse sage) et démon (dans les visions folles de son mari, Serge Reggiani, persuadé qu’elle le trompe). Mais surtout, elle accepte tout : faire du ski nautique pendant des jours, porter du rouge à lèvres bleu, se glisser nue sous un catafalque transparent.
Aujourd’hui, que reste-t-il d’elle ? Une plastique parfaite sanglée dans un maillot de bain noir (chez Deray). Des cheveux tirés en arrière qui lui donnaient le port de tête d’une écuyère (chez Sautet). Des personnages où les Françaises reconnaissaient des bribes de leur existence (Sautet, encore). Et cette façon de s’écorcher vive sur les arêtes de chaque rôle pour se dépasser (chez Zulawski). «Je n’ai peur de rien, sinon de moi-même », disait-elle.
Car elle souffrait. Elle souffrait de ce qu’elle croyait être ses limites. Mais aussi des abus d’une certaine presse avide d’intimité, qui n’hésita pas à la crucifier lorsque les choses de la vie (abus d’alcool et d’anxiolytiques, mort tragique de son fils David) la rattrapèrent. L’actrice s’est grandie devant nous. Elle s’est rebellée devant nous. Elle y a tout perdu. Elle y a tout gagné, et, d’abord, une part d’éternité.
Romy vu par...
ISABELLE CARRÉ
«Je l’ai découverte dans Une femme à sa fenêtre (de Granier-Deferre). J’ai tout de suite attrapé un stylo et noté ses répliques. Un geste irrationnel : je voulais garder une trace d’elle. Je l’ai revue dans L’Important, c’est d’aimer (de Zulawski) et… je me suis acheté tous ses films. César et Rosalie (de Sautet) me fascinait. J’ai appris la lettre de Rosalie à David et passé mes castings grâce à elle. C’était mon petit joker. Je la reprogramme encore sur mon iPod pour me donner de l’énergie. Romy Schneider est l’actrice à vif, l’actrice de l’émotion à fleur de peau. Personne ne s’est exposé autant qu’elle. Elle n’a pas voulu rester une petite Agnès de L’École des femmes que sa beauté enfermerait. Chaque soir, sur le tournage de La Mort en direct, elle glissait à Bertrand Tavernier des lettres sous sa porte. Ce fourmillement de mots, écrits dans tous les sens, disait sa fébrilité chargée de doutes, son enthousiasme et sa reconnaissance.»
SANDRINE KIBERLAIN
«Deux actrices me bouleversent : Ingrid Bergman, dont la froideur m’énervait, mais dont j’ai fini par devenir folle ; et Romy Schneider, qui ne mettait aucune distance entre sa douleur et celle de ses personnages. Elle me choquait presque par l’intensité de ce qu’elle montrait d’elle à l’écran, notamment dans L’Important, c’est d’aimer. Peut-être est-elle, d’ailleurs, morte de ça, elle qui a subi tant d’épreuves. Moi, je ne me réfère pas aux miennes. Je n’ai, par exemple, jamais pensé à la mort de mon père pour jouer un immense chagrin, car il me semble que je sortirais aussitôt du film et du rôle. J’adorais ses gestes. Sa manière de trimbaler une écharpe… Toute autre qu’elle se serait empêtrée. Cette vérité, sensible jusque dans sa façon de bouger. Et dans les films de Sautet, où elle personnifiait la femme libre. Romy Schneider remplissait l’image. Depuis, je cherche quelqu’un qui, comme elle, la remplisse.»
BÉRÉNICE BEJO
«Un matin, j’ai reçu une lettre : les réalisateurs de L’Enfer me proposaient de lire des séquences du scénario de Clouzot. J’ai tout de suite posé mes conditions : il n’y aurait aucune mise en scène, je tiendrais toujours le scénario en main et je ne jouerais pas. Il était hors de question que l’on me compare à Romy. Je ne voulais pas risquer que les spectateurs se demandent : mais comment ose-t-elle ? J’ai aussi travaillé ma voix pour la rendre le plus humble possible. Dans L’Enfer, Romy Schneider, 26 ans, était dans la vie. Elle faisait des grimaces lors des essais costumes (muets), et si on lit sur ses lèvres, on se rend compte qu’elle soupire parfois : “J’en ai marre.” Elle avait quelque chose d’incroyablement sexy. Regardez-la faire rebondir ce petit gadget en forme de spirale sur son corps nu. Si Romy m’inspire, c’est qu’elle incarne l’abandon. Elle se situe à la hauteur d’une Gena Rowlands.»
AUDREY DANA
«Elle avait un grand front, elle n’était pas la fille la mieux "gaulée" de la terre, mais sa beauté coupait le souffle. Son investissement et son énergie brute en faisaient surtout une actrice rare que je comparerais à Cate Blanchett. La vie tourmentée de Romy, qui a traversé l’impensable, entretenait une forte résonance avec ses personnages. Elle renvoie donc souvent un sentiment de mise en danger. Quand ma vie a basculé avec Roman de gare (de Lelouch), on m’interrogeait : "Que voudriez-vous faire désormais ?". Je répondais : "Tourner dans le biopic sur Romy Schneider". En 2008, j’ai obtenu le prix Romy-Schneider. Elle aimait les rôles qui n’étaient pas gagnés d’avance. Son exigence, qu’elle vivait comme une souffrance, me guide. C’est le carburant de ceux qui avancent.»
Romy en résonances
EMMANUELLE BÉART, L’HÉRITIÈRE : Claude Chabrol la choisit pour L’Enfer, inspiré du film inachevé d’Henri-Georges Clouzot ; Claude Sautet, pour Un cœur en hiver. Deux films hantés par Romy Schneider.
SARAH BIASINI, LA FILLE : elle l’est dans la vie. Sur scène dans la pièce "Pieds nus dans le parc", de Neil Simon, où, des pommettes (un peu plus prononcées) jusqu’à la bouche, elle ressuscite les traits de sa mère.
ROXANE MESQUIDA, LA PETITE SŒUR : Benoît Jacquot (L’École de la chair) et Catherine Breillat (À ma soeur) ont vu en elle la femme fatale derrière l’ingénue. Un parcours proche de celui de Romy.
GÉRALDINE PAILHAS, LA GRANDE SŒUR : François Ozon, qui adorait Romy, l’a dirigée dans 5 fois 2. Cheveux tirés, beauté pure, sans fard, la filiation est évidente.
LAURA SMET, LA PETITE COUSINE : un visage de fauve au repos et un rôle dans UV, de Gilles Paquet-Brenner, qui rappelle à la fois La Piscine, de Jacques Deray, et Plein Soleil, de René Clément.
09h51 dans Film-1964-Enfer, Presse - 2009, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (2)
12 juillet 2009
Le Figaro - N° 19 996 - 13 novembre 2008
|
Article intérieur : 1,5 page |
Bientôt un film sur la vie de Romy Schneider
Coup d'envoi, en mars prochain, du tournage de «Romy», joué par Yvonne Catterfeld, une jeune chanteuse allemande, véritable clone de l'actrice disparue.
Les biopics se suivent et ne se ressemblent pas… Après Sagan, Piaf, Coluche et en attendant Gainsbourg et deux films sur la vie de Coco Chanel, on prépare un long-métrage sur Romy Schneider. Coproduction franco-allemande, le film qui doit être tourné en mars 2009 sera financé pour la France par Raymond Danon et réalisé par le metteur en scène germanique Josef Rusnack. Il racontera les grandes lignes de la vie privée et de la carrière de l'actrice, des premiers Sissi à sa disparition tragique en 1982.
Pour incarner l'interprète des Choses de la vie, c'est Yvonne Catterfeld, une chanteuse allemande de 29 ans à la troublante ressemblance, qui a été choisie aux côtés du jeune acteur français Raphaël Personnaz qui jouera Alain Delon. Sa mère, Magda Schneider, sera interprétée par Gudrun Landgrebe, Jean-Hugues Anglade incarnera Claude Sautet ; Tchéky Karyo, le producteur Raymond Danon, et Clément Sibony, son dernier mari, Daniel Biasini. Et on cherche encore l'acteur qui sera Jean-Claude Brialy.
Cette saga intitulée sobrement Romy, qui traversera une quarantaine d'années de cinéma, de bonheur et de drames, devrait bénéficier d'un budget de 13 millions d'euros et être tournée en Allemagne, à Berlin, à Paris, dans le sud de la France et en Roumanie.
« L'histoire d'une jeune fille jetée dans le ciel des stars »
Selon la maison de production allemande Movie Company, dirigée par Douglas Welbat, « le film sera une sorte d'hommage à une femme et à une actrice qui a su faire rimer vie privée et vie professionnelle. L'histoire d'une jeune fille jetée dans le ciel des stars quand elle était très jeune et qui a tenté d'avoir une vie sur la terre ». Et les responsables insistent : «On ne se concentrera pas sur les rumeurs et les scandales qui ont pu jalonner sa carrière. Nous mettrons plutôt en lumière ses aspects positifs, même si on évoquera quelques drames comme la disparition tragique de son fils.»
Pour sa part, le producteur français Raymond Danon précise : «Le film s'est fait avec l'accord de sa fille Sarah et de son mari Daniel Biasini. Pour l'interprète, nous avons vu une trentaine d'actrices et nous nous sommes arrêtés sur Yvonne Catterfeld. Elle est formidable. Quant à Raphaël Personnaz, il interprète Alain Delon. Moi qui ai fait onze films avec ce dernier, je l'ai prévenu pour avoir son accord. Il n'a jamais répondu mais il paraît qu'il n'est pas très content d'être interprété dans un film… Je le comprends. Mais qui peut vraiment interpréter Delon ?»
02h36 dans Films-Romy, Presse - 2008, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
07 juin 2009
13 novembre 2008
Le Figaro - 13 novembre 2008
|
Article intérieur sur le projet de film "Une femme comme Romy" 1/2 page |
Source : Le Figaro.fr - 13 novembre 2008
Bientôt un film sur la vie de Romy Schneider
Coup d'envoi, en mars prochain, du tournage de « Romy », joué par Yvonne Catterfeld, une jeune chanteuse allemande, véritable clone de l'actrice disparue.
Les biopics se suivent et ne se ressemblent pas… Après Sagan, Piaf, Coluche et en attendant Gainsbourg et deux films sur la vie de Coco Chanel, on prépare un long-métrage sur Romy Schneider. Coproduction franco-allemande, le film qui doit être tourné en mars 2009 sera financé pour la France par Raymond Danon et réalisé par le metteur en scène germanique Josef Rusnack. Il racontera les grandes lignes de la vie privée et de la carrière de l'actrice, des premiers Sissi à sa disparition tragique en 1982.
Pour incarner l'interprète des Choses de la vie, c'est Yvonne Catterfeld, une chanteuse allemande de 29 ans à la troublante ressemblance, qui a été choisie aux côtés du jeune acteur français Raphaël Personnaz qui jouera Alain Delon. Sa mère, Magda Schneider, sera interprétée par Gudrun Landgrebe, Jean-Hugues Anglade incarnera Claude Sautet ; Tchéky Karyo, le producteur Raymond Danon, et Clément Sibony, son dernier mari, Daniel Biasini. Et on cherche encore l'acteur qui sera Jean-Claude Brialy.
Cette saga intitulée sobrement Romy, qui traversera une quarantaine d'années de cinéma, de bonheur et de drames, devrait bénéficier d'un budget de 13 millions d'euros et être tournée en Allemagne, à Berlin, à Paris, dans le sud de la France et en Roumanie.
«L'histoire d'une jeune fille jetée dans le ciel des stars»
Selon la maison de production allemande Movie Company, dirigée par Douglas Welbat, «le film sera une sorte d'hommage à une femme et à une actrice qui a su faire rimer vie privée et vie professionnelle. L'histoire d'une jeune fille jetée dans le ciel des stars quand elle était très jeune et qui a tenté d'avoir une vie sur la terre». Et les responsables insistent : «On ne se concentrera pas sur les rumeurs et les scandales qui ont pu jalonner sa carrière. Nous mettrons plutôt en lumière ses aspects positifs, même si on évoquera quelques drames comme la disparition tragique de son fils.»
Pour sa part, le producteur français Raymond Danon précise : «Le film s'est fait avec l'accord de sa fille Sarah et de son mari Daniel Biasini. Pour l'interprète, nous avons vu une trentaine d'actrices et nous nous sommes arrêtés sur Yvonne Catterfeld. Elle est formidable. Quant à Raphaël Personnaz, il interprète Alain Delon. Moi qui ai fait onze films avec ce dernier, je l'ai prévenu pour avoir son accord. Il n'a jamais répondu mais il paraît qu'il n'est pas très content d'être interprété dans un film… Je le comprends. Mais qui peut vraiment interpréter Delon ?»
Dominique Borde
Une belle carrière ponctuée de bonheurs et de drames
Il y a vingt-six ans, l'actrice fétiche de Claude Sautet disparaissait brutalement, laissant le public inconsolable.
Le 29 mai 1982, la nouvelle tombait comme un coup de tonnerre et l'épilogue d'une tragédie : Romy Schneider était morte dans la nuit, à l'âge de 44 ans. Une vie s'arrêtait tandis qu'une autre continuait sur l'écran pour nous laisser inconsolable, frustré sans doute de ne pas pouvoir la voir vieillir, coupable peut-être aussi de ne pas avoir compris qu'une femme était passée bien avant une vedette. La nostalgie qui est souvent une mauvaise habitude renvoie toujours le portrait en pied de Sissi où la jeune fille de dix-sept ans devient à la fin des années 1950 une héroïne de roman-photo rose et or. Il faudra attendre une bonne dizaine d'années et Les Choses de la vie de Claude Sautet pour que l'image commence à s'estomper ou au moins à se déplacer.
De "César et Rosalie" à "La banquière", en passant par son rôle pathétique dans "L'important c'est d'aimer", l'autre Élisabeth d'Autriche du "Crépuscule des dieux" ou la femme sacrifiée du "Vieux Fusil", Romy devient l'égérie des années 1970. Le cinéma est alors comme le miroir qui reflétera son humanité, sa force véhémente, ses faiblesses bouleversantes. Sans oublier son charme. Celui qu'elle exprime du côté de Sautet ou en retrouvant Delon son premier grand amour dans "L'assassinat de Trotsky" de Losey ou La Piscine de Deray.
Des blessures indélébiles
Mais est-ce la femme que l'on regarde ou l'actrice que l'on applaudit ? C'est dans cette équivoque que Romy existe à la fois comme une comédienne capable de passer d'un drame à une comédie grinçante et comme une actrice populaire. Son jeu n'est peut-être qu'un dédoublement, ses interprétations l'incarnation d'un malaise plus intime et profond. Et si la tragédienne est devenue un exemple que les femmes voudraient suivre et que les hommes rêvent d'apprivoiser, la vraie Romy est au-delà de ces conventions affectives. Car sa vérité ce sont aussi les grandes douleurs de sa vie comme le suicide de son premier mari ou la mort accidentelle de son fils David en 1981. C'est beaucoup et c'est trop quand le drame vous rattrape au mauvais tournant d'un rôle que l'on n'a pas choisi.
Vingt-six ans après, que reste-t-il alors de ses bonheurs radieux, de ses blessures indélébiles ? Un souvenir toujours vivace qui s'accroche à des images. Ici l'inévitable "Sissi" qui fait toujours rêver les jeunes filles en quête de prince charmant, l'héroïne d'Orson Welles dans "Le Procès", la maîtresse révoltée des "Choses de la vie", Lily la prostituée manipulée de "Max et les Ferrailleurs", la femme perdue et pathétique du "Train", celle aimante et torturée du "Vieux Fusil", ou encore l'épouse volage d' "Une femme à sa fenêtre". Quand ce n'est pas l'actrice paumée de "L'important c'est d'aimer" ou la compagne sexy et insatisfaite de "La piscine"…
À moins que tous ces rôles célèbres se résument à un seul et à une photo prise dans les coulisses du tournage de "Ludwig, le crépuscule des dieux" de Visconti. On la voit dans la robe d'Élisabeth d'Autriche, à genoux devant son fils David, alors âgé de 6 ans, coiffé d'un casque de dragon. La promesse d'une carrière alors à son zénith, le bonheur au bord d'une future douleur et l'amour maternel bientôt endeuillé. Il y a là dans ce cliché comme la synthèse de toute sa vie : le cinéma au superlatif, le costume d'un personnage qui la poursuivra tout le temps, et une femme à genoux devant un enfant chéri qui partira trop tôt. Le spectacle et l'intimité confondus, les coulisses d'un tournage qui rejoignent celles de son existence et l'ombre d'une blessure qui ne pourra jamais se refermer.
C'est peut-être cette simple image arrachée au hasard qui restera comme la trace indélébile de Romy Schneider.
09h36 dans Films-Romy, Presse - 2008, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)
05 octobre 2008
03 août 2007
Figaro Magazine - N° 13782 - 24 décembre 1988
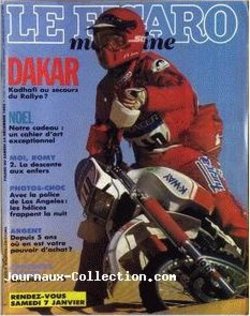 |
Article intérieur : * Moi, Romy - Le journal intime d'un conte de fées devenu tragédie (2e partie) 8 pages Première partie de l'article dans le Figaro N° 13781 |
10h59 dans Presse - 1988, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (1)
01 août 2007
Figaro Magazine - N° 13781 - 17 décembre 1988
 |
Article intérieur : * Moi, Romy - Le journal intime d'un conte de fées devenu tragédie 9 pages La suite de l'article dans le Figaro N° 13782 |
10h45 dans Presse - 1988, Revue Figaro | Lien permanent | Commentaires (0)

